bo
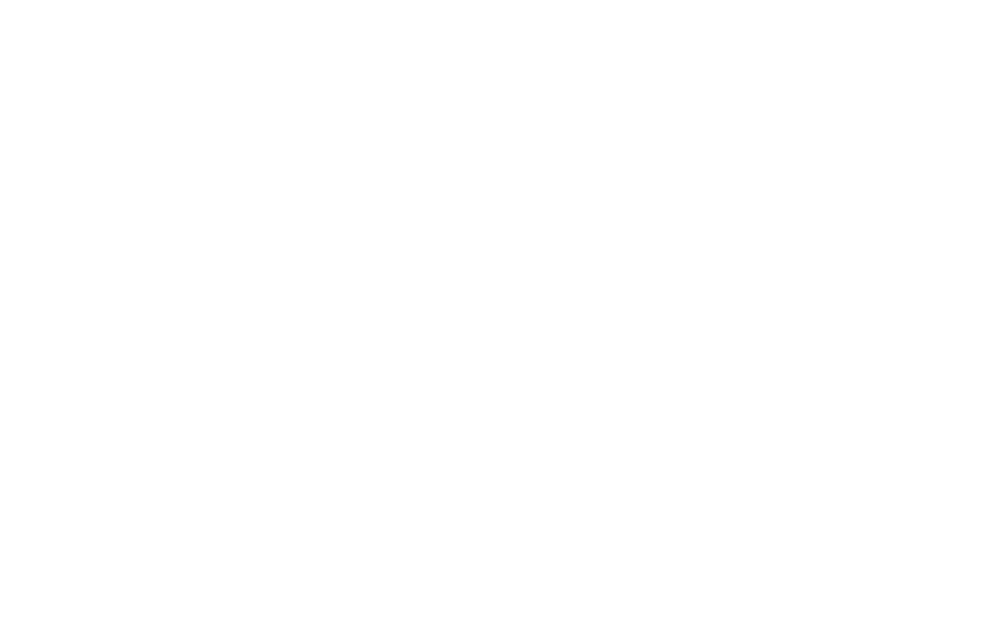
 Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Partager
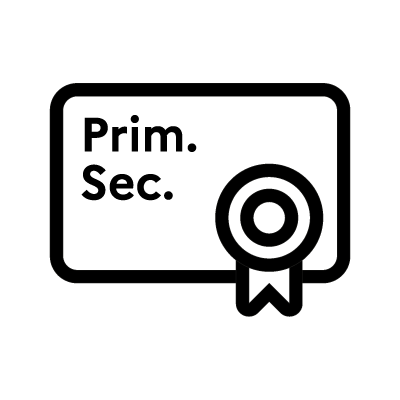 Enseignements primaire et secondaire
Enseignements primaire et secondaire
Baccalauréat général
Programme limitatif de l’enseignement de spécialité de cinéma-audiovisuel en classe terminale pour l’année scolaire 2024-2025
NOR : MENE2330066N
Note de service du 4-12-2023
MENJ - Dgesco C1-3
Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France ; aux inspecteurs et inspectrices d’académie-inspecteurs et inspectrices pédagogiques régionaux ; aux cheffes et chefs d’établissement ; aux professeures et professeurs de cinéma-audiovisuel
Références : arrêté du 19-7-2019 publié au BO spécial n° 8 du 25-7-2019
Le programme d’enseignement de spécialité de cinéma-audiovisuel en classe terminale institue un programme limitatif de trois œuvres cinématographiques et audiovisuelles, publié tous les ans au Bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Il est renouvelé annuellement par tiers. Au cours de l’année de terminale, chaque œuvre est abordée et analysée dans la perspective d’un ou plusieurs questionnement(s) précisé(s) par le Bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Chaque œuvre permet donc d’actualiser concrètement l’étude d’un ou plusieurs questionnement(s) au programme de l’enseignement de spécialité cinéma-audiovisuel de terminale.
Pour l’année scolaire 2024-2025, les œuvres cinématographiques retenues sont les suivantes :
I Vitelloni (Les Vitelloni) de Federico Fellini, 1953
I Vitelloni, le troisième film de Federico Fellini (Rimini, 1920 – Rome, 1983), n’appartient pas à ce que l’on appelle communément « l’âge d’or du cinéma italien », qui débute avec les années 1960, mais il s’inscrit dans une époque où le cinéma italien commence à rompre avec le néoréalisme d’après-guerre. Les premières transformations sont perceptibles à l’orée des années 1950 dans Miracle à Milan de Vittorio de Sica (1951), œuvre dans laquelle le réalisme se mêle au merveilleux, dans Stromboli de Rossellini (1950) ou encore dans Bellissima de Visconti (1951), où « la représentation du collectif s’étiole au profit de portraits individuels ». Elles se poursuivent avec la rupture politique que peut marquer en 1952 Umberto D. ou encore l’année 1954, qui connaît la sortie conjointe de films aussi différents que La Strada de Fellini, Voyage en Italie de Rosselini, Senso de Visconti ou encore Un Américain à Rome de Steno.
I Vitelloni se situe au tournant : sorti en 1953, l’action du film se déroule au cours de cette même année – la première scène se passe pendant l’élection de « Miss Irena 1953 » – et elle met en scène un type de personnage nouveau, « les gros veaux », que le titre français a rendu par « les inutiles » : cinq hommes, « Tanguy » de leur génération, bien que trentenaires, vivent aux crochets de leur famille et passent leur journée en déambulations dans la ville ou sur la plage, en jeux, festivités diverses et flirts incessants. Ils sont hâbleurs, trompent, mentent, corrompent, volent, rien ne les arrête pour que, coûte que coûte, leur vie se déroule dans le farniente et les plaisirs épicuriens. « J’ai toujours raconté l’histoire du mâle italien, lâche, égoïste et puéril. Les femmes de mes films sont toujours vues à travers les yeux d’un protagoniste masculin qui est prisonnier de certains tabous, conditionné par une éducation catholique […] », commente Fellini. Pour autant, les personnages féminins ne sont pas particulièrement mis en valeur dans I Vitelloni : Sandra, l’épouse de Fausto, le « gigolo », est d’une naïveté à faire pleurer ; quant à Olga, la sœur d’Alberto, fainéant et profiteur, gardien de la morale catholique, elle subit les défauts et les critiques de son frère sans sourciller, l’entretenant autant que de besoin. Confusément, pourtant, ces personnages sont en quête d’une transcendance et d’une grâce (comme dans la scène burlesque du vol de l’ange) qui se trouvent caricaturées à leur contact et qui semblent les fuir.
Ce film, constitué de saynètes qui s’enchaînent les unes aux autres, nous faisant passer d’un moment de vie d’un personnage à un autre, d’une scène entre les cinq amis à une autre, mime l’ennui et l’écoulement du temps dans une ville de province, probablement Rimini, que connaît bien le réalisateur puisqu’il y est né. Comédie traversée par des scènes qui ne sont pas sans rappeler le mime – on pense par exemple à la scène dans laquelle Alberto se moque grossièrement des « lavatori » –, où les personnages (et le spectateur) s’amusent, I Vitelloni a aussi la saveur du drame que l’esthétique en noir et blanc, le jeu des ombres et des lumières viennent souligner – cf. la scène entre Sandra et Fausto à la sortie du cinéma ou la chambre de Moraldo écoutant sa sœur pleurer – et qu’annoncent l’orage interrompant brutalement les festivités de la première scène ainsi que le motif, très fellinien, du « vent qui vient de la mer » et balaie tout sur son passage. Combien de temps pourra vraiment durer cette vie corrompue et idiote ?
La musique du film, celle de Nino Rota, qui travailla avec Fellini du Cheik blanc en 1952 à Répétition d’orchestre en 1978, qui signa plus de 170 musiques de film et fut célébré aux Oscars de 1972 pour celle du Parrain, met en évidence cette oscillation entre comédie et drame : musique de cirque, elle peut également être symphonie aux notes inquiétantes, tristes ou mélancoliques. On notera également qu’à deux reprises, notamment dans la grande scène du Carnaval, c’est la célèbre Nonsense Song que chante Charlot dans Les Temps modernes qui accompagne le bal où les couples dansent joyeusement, se lient et se délient, cette musique, au titre signifiant, venant comme illustrer la thématique centrale du film. Ce sera le personnage le moins « Vitellono » des cinq qui quittera cette vie de non-sens : le frère de Sandra, Moraldo, s’en va en train, les bruits de la locomotive venant se poser sur les images de ses compagnons dormant dans la sérénité illusoirement retrouvée.
On étudiera plus particulièrement I Vitelloni dans la perspective des questionnements suivants :
- Périodes et courants
Si le film s’éloigne du néoréalisme historique, lié au droit d’inventaire par le regard d’une nation en reconstruction, il n’en récupère pas moins certains traits caractéristiques (la peinture sociale, le bilan d’une époque, l’inscription dans un paysage – fût-il urbain) que Fellini fait siens et accommode de sa tonalité propre : autant Rossellini avait lancé, avec Rome ville ouverte, le néoréalisme sur la voie d’un art de la juste distance, à la fois proche et loin, autant Fellini ne craint plus l’empathie, l’outrance, voire la nostalgie teintée de souvenirs personnels, avec ses vilains garçons.
À travers ces comparaisons de part et d’autre de la fin officielle du néoréalisme, ce sont bien les mutations d’un courant cinématographique, principal vecteur de renouveau du cinéma de l’après-guerre, qui méritent d’être interrogées, et, au-delà, la manière dont s’écrit l’histoire du cinéma : par glissements et pivots autour d’œuvres centrales plutôt que par ruptures.
- Un cinéaste au travail
L’analyse de la genèse et de la production du film, appuyée notamment sur des documents spécifiques (notes de travail, extraits de scenarii, dessins préparatoires), permet de retracer les différentes étapes de la fabrication d’un chef-d’œuvre.
Se pose en particulier la question de la continuité fascinante de l’imaginaire fellinien à toutes les étapes d’élaboration du film : dès les dessins préparatoires, le film est là, dans une cohérence qui donne à ce processus créatif les allures d’une création continuée – qui pourra nourrir en retour celui des élèves.
High School de Frederick Wiseman, 1968
1968. La France connaît l’un des mouvements sociaux les plus importants de son histoire, durant lequel éclate la révolte des étudiants qu’accompagnent manifestations d’ampleur et grève générale. Aux États-Unis, alors que le pays est massivement engagé dans la guerre du Vietnam, on prend conscience, à la suite de l’offensive du Tết, de la force militaire du Viêt-cong qui parvient à occuper pendant plus d’un mois les faubourgs de Saïgon et la citadelle de Hué, tuant quelque trois mille personnes liées à la république du Vietnam. Les mouvements d’opposition, notamment estudiantins, sont de plus en plus massifs : des campus sont occupés, celui de Columbia en avril, et de fréquents affrontements opposent les jeunes et les forces de police, comme à Chicago à la fin du mois d’août. Au cœur de cette tourmente, le Civil Rights Movement se poursuit, et l’année 1968 est marquée par l’assassinat de Martin Luther King, le 4 avril. C’est au cœur d’une vague d’émeutes que le président Johnson promulgue, le 11, le nouveau Civil Rights Act. Deux mois auparavant, en février, la NASA présente les cinq sites d’atterrissage potentiels sur la Lune, quand, le 21 janvier, Simon and Garfunkel sortent l’album The Graduate, qui contient le célèbre « Mrs Robinson » et s’empare, en avril, de la première place du Billboard 200.
Tous ces événements traversent High School, le deuxième film documentaire de Frederick Wiseman, mais à bas bruit, soit subrepticement, comme par flash (« Le Club du Spectateur va discuter de l’assassinat de Martin Luther King », 58’07-58’13 ; la présence soudaine d’un policier dans un couloir de l’établissement, 58’14-58’22), soit dans des séquences qui y renvoient plus ou moins directement (« Qui serait membre d’un club où il y aurait une minorité de noirs […] et d’un club dont la moitié des membres serait noire, l’autre blanche ? […] Combien refuseraient ? Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. », 52’32-53’14 ; la séquence consacrée au projet Sparc, 1’05’44-1’08’56 ; la séquence finale consacrée à la lecture publique de la lettre de Bob Walters, ancien élève du lycée, qui s’engage au Vietnam, 1’10’19-1’14’12). De fait, Northeast, lycée d’enseignement secondaire public de Philadelphie en Pennsylvanie, que le cinéaste filme pendant cinq semaines entre mars et avril 1968, ne semble pas vibrer des révoltes qui grondent à l’extérieur (« Le lycée Northeast est un endroit si cloîtré, si retiré. », 53’47). Sans voix off ni musique, sans aucun accompagnement – à la manière d’un Charles Reznikoff, ce poète objectiviste américain qui accueille dans sa poésie, matériaux bruts, les témoignages entendus lors de procès sans ajouter un mot qui lui soit propre –, le film, qui va fonder le cinéma-vérité, avec une méthode reprise par Richard Leacock en Angleterre et Raymond Depardon en France, est comme dédramatisé et neutre.
Néanmoins, cette neutralité, cette objectivité d’un réalisateur qu’on a le sentiment de ne pas sentir n’est qu’apparence. C’est pourquoi, afin d’en cerner la construction et l’expression d’une part, et la réception d’autre part, on étudiera plus particulièrement High School dans la perspective des questionnements suivants : « Un cinéaste au travail » et « Réceptions et publics ». Attention, une modification a été apportée au questionnement proposé dans le programme limitatif précédent où celui-ci apparaissait au singulier : « Réception et public ».
Pour ce faire, on étudiera le découpage des séquences et le montage, qui, jouant par capillarité, sont la plupart du temps porteur de sens. On pourra, par exemple, mettre en évidence l’opposition entre l’apparence et la réalité que révèle le passage de la séquence chorale (53’15-53’44), où les élèves répètent studieusement sous la baguette de leur professeur, à celle qui montre un étudiant, aux lunettes noires tel John Lennon, exprimant, devant ses camarades et son enseignante, sa colère au sujet de ce lycée-cloître, de ce « lycée qui pue » (54’24). Par ailleurs, on interrogera les effets et les symboliques des gros plans, constants dans le film, sur des parties du corps – les oserait-on toutes aujourd’hui ? –, sur des visages, de face ou de profil, sur des bouches qui parlent (1’29), qui chantent (53’37), sur des yeux et des regards, que parfois dérobent voire déforment des lunettes d’un autre âge (41’29) ou qui révèlent des pensées en train de se faire (36’54), des imaginaires en fuite (37’03), sur des gestes d’apprentissage (18’57-19’07), mais aussi sur de multiples objets personnels et quotidiens.
On réfléchira enfin au choix du (presque) huis clos. En effet, le lycée apparaît à l’écran davantage comme une sorte de citadelle, entourée de ses remparts grillagés, le travelling horizontal de la séquence d’ouverture (00’38) plantant le décor, avec ses longs couloirs à l’allure de couloirs de prison, souvent vides (37’30), dans lesquels une figure d’autorité est susceptible de demander aux étudiants s’ils ont un « laissez-passer » (13’09-14’38). Un lycée, « moralement et socialement, poubelle » (56’49), dans lequel on enseigne le fait que « le monde vous reconnaît selon vos résultats » (8’40), que « tenue de soirée » signifie robe longue ou smoking (29’04-32’19), que « si un couple vit ensemble, la société considère qu’ils sont mariés, et c’est ainsi formidable : la société sait prendre soin d’unions régulières, responsables et stables » (26’56), que « plus un garçon ou une fille a de rapports avant le mariage, moins ils feront de bons partenaires de mariage » (59’24). Un lycée dans lequel, en présence de la mère dont le gros plan sur le regard semble trahir les pensées (45’08), une probable conseillère d’orientation pose au seul père « la question cruciale : “de quel budget disposez-vous pour les études de votre fille ?” » (45’01).
Au fil du propos du film, sans éclat ni coup de force, ce sont bien les stéréotypes de classes, de genres, de pouvoir, qui sont démontés et révélés, et notamment ceux que véhicule le modèle éducatif à l’œuvre. « En matière d’éducation, de ses relations avec le monde d’aujourd’hui, ce lycée est pitoyable, c’est un vrai cloître. Il est complètement coupé de ce qui se passe dans le monde. Il faut changer ça. C’est notre but ici. Et non pas de parler cinéma. » (54’33-54’46). Et la fin du film de venir confirmer cette hypothèse : à la suite de l’expression publique de satisfaction d’un membre de la direction (ou d’une professeure) devant l’engagement d’un ancien élève au Vietnam (« Le fait de recevoir une telle lettre me fait penser que nous avons réussi notre travail, ici, au lycée Northeast », 1’14’00-1’14’10), le cinéaste coupe avant toute éventuelle réplique de la part des lycéens que, par ailleurs, tout à fait exceptionnellement, il choisit de ne pas montrer. Leur réponse est comme volée par l’adulte (« Je pense que vous en conviendrez », 1’14’11), mais le découpage de la séquence ouvre à des horizons de grogne possibles. Y a-t-il pour autant un jugement de la part de Wiseman ? Sans doute pas au sens où il chercherait à nous imposer son point de vue. La discrétion de celui-ci, même dans l’efficace des visibilités restaurées, vise sans doute surtout à éveiller notre faculté de juger et à nous laisser maîtres du final cut moral.
On s’en doute, au moment de sa sortie, le film a été fort mal perçu par le personnel de l’établissement, qui menaça Frederick Wiseman de poursuites judiciaires. Il ne sera pas projeté à Philadelphie. Pourtant, c’est une méthode qui s’invente ici et se perfectionne : des cinéastes héritiers qui la déclineront (et même à notre époque, notamment avec Claire Simon) jusqu’aux sociologues qui se l’approprieront, la réception de High School est vivante et complexe.
Irma Vep d’Olivier Assayas, mini-série, épisodes 1, 2 et 3, 2022
Olivier Assayas n’en est pas à sa première incursion dans la série lorsqu’il se lance pour HBO dans le projet Irma Vep, mini-série de 8 épisodes. Entre le « grand film intimiste » qu’est L’Heure d’été (selon la belle formule de Jacques Mandelbaum) et Après mai, portrait de la jeunesse des années 1970, il livra, à la surprise générale, le biopic Carlos, qui retrace la vie du terroriste international Ilich Ramírez Sánchez. Qualifié de « film », le projet est proposé en deux versions : l’une de cinq heures et trente minutes, présentée à Cannes et diffusée en trois épisodes sur Canal+, l’autre de deux heures et quarante-cinq minutes, qui sortit en salles. L’auteur avait déjà esquissé un semblable jeu de variations avec le téléfilm La Page blanche (réalisé pour Arte) et sa réécriture au format « cinéma » sous le titre L’Eau froide. Intégrant pleinement l’incidence des supports et des circuits de diffusion sur ses choix de réalisateur, Assayas cherchait très consciemment dès ces premiers essais à en éprouver l’effet sur le spectateur. Aussi, lorsque René, le réalisateur de la série en abîme Irma Vep, dont on suit la douloureuse genèse au fil des épisodes de la série du même nom, rencontre un médecin chargé par les assurances d’évaluer sa santé et sa capacité à achever le projet, tout va bien jusqu’au moment où l’on sort du registre strictement médical pour entrer dans celui de l’esthétique. Une controverse se déclenche en effet sur la nature de la production : « feuilleton » pour le médecin, « film » et rien que « film » – certes au travers d’une durée plus longue – pour René qui se fait ici l’écho, sinon de l’inquiétude d’Assayas, du moins de ses ambitions et doutes. Qu’est-ce donc qui qualifie ou disqualifie la valeur d’une création ? La pureté de son intention ? Son circuit de diffusion ou son format ? Les choix et gestes de son auteur ? Sa réception, immédiate ou ultérieure ? Et par quel public ? À quel prix les images sortent-elle du régime du flux pour entrer dans celui de l’Art ? Cela relève-t-il d’une qualité intrinsèque ou extrinsèque ? Questions essentielles qui sont celles qu’affronte actuellement le secteur cinématographique, plus que jamais superposé et assujetti à celui de l’audio-visuel, et qu’Irma Vep ne cesse de réfléchir avec drôlerie, grâce, fantaisie, et lucidité.
L’on suit ainsi autant la création d’une aventure (remake du fameux serial de Louis Feuillade) que les aventures d’une création. Une multitude d’intrigues et de péripéties s’entrecroisent, se ramifient et se correspondent sur la trame du tournage d’un « film », donc : un réalisateur aliéné jette les derniers crédits qu’il lui reste dans une tentative folle de réécriture d’un vieux classique du muet pour tenter de réanimer la flamme et les mannes du cinéma des origines ; une jeune star américaine, la bien-nommée Mira (à la fois « merveilleuse » et « regard »), habituée aux grosses productions hollywoodiennes, cherche en Europe une parenthèse enchantée, afin de redonner du sens à sa carrière et à sa vie ; un vieux mécène, pas si philanthrope que cela, finance le projet pourvu que sa star devienne l’égérie de sa prochaine campagne de parfum ; un acteur allemand junkie ne peut tourner que si on lui trouve son carburant quotidien ; un jeune premier fait des histoires de tout, pour se donner de l’importance, et, par-dessus tout, un maître-réalisateur orchestre ce ballet incessant de désirs pour tromper ses angoisses de création (René comme double distancié d’Olivier) et rappeler à lui le souvenir de ses amours défuntes.
Si le postulat peut rappeler celui de La nuit américaine de Truffaut, la richesse, la variété de ton, la grande liberté que permet le format sériel donne à Irma Vep l’ampleur d’une quête symbolique et cathartique : de petites en grandes histoires, de tribulations dérisoires en caprices de stars, d’amourettes en grandes histoires d’amour, d’approximations en cristallisations, de regrets en deuils accomplis, c’est moins la force réparatrice du cinéma sur la vie qui est interrogée, que la manière dont le cinéma peut faire œuvre par-delà le chaos. Au travers d’une multitude de ratés ou de hasards, de grands aléas ou de victoires dérisoires, la grande magie invocatoire des images opérera, malgré tout, malgré nous, s’il nous est donné d’y croire jusqu’au bout.
S’il est recommandé que les élèves découvrent l’intégralité de la série, le programme se limite à l’étude des trois premiers épisodes, qui forment – autour du personnage de Mira, de son arrivée à Paris et de ses premiers contacts professionnels et personnels avec le milieu parisien – un arc narratif complet qui lance cependant l’ensemble des pistes de l’œuvre.
On étudiera plus particulièrement les épisodes 1, 2 et 3 d’Irma Vep dans la perspective des questionnements suivants :
- Un cinéaste au travail
Jouant avec le « décalage » de Mira (horaire, personnel, culturel et professionnel), Olivier Assayas tire profit de son regard candide (une Roxane en Pays de Cocagne de « Libre cinéma ») pour interroger à neuf les conditions de création d’une fiction en 2022. Ce faisant, Irma Vep peut être autant étudié comme un documentaire en miroir sur son propre tournage que comme un état des lieux du cinéma et du désir, autant comme un carnet de création drolatique et distancié que comme un traité de « Conseils à un jeune cinéaste » (dont les élèves feront leur miel), autant comme une déclaration d’amour que comme un pamphlet, autant comme une auto-réflexion sur toute son œuvre par le cinéaste que comme une réactivation occulte de sa force et mémoire. Aussi le dialogue permanent et subtil que ménage Irma Vep la mini-série avec Irma Vep (le film de 1996) constitue-t-il le point de mire et d’incandescence de tout le dispositif. Par quoi un artiste est-il hanté lorsqu’il crée ? Et nous, qui visionnons son œuvre, quelles images-fantômes viennent nous assaillir ?
- Art et industrie
Et dans tout cela, s’agit-il « par ailleurs d’une industrie » pour paraphraser une célèbre formule ? Certainement. À travers les vicissitudes de la production, et notamment le personnage interprété par Pascal Grégory – alter ego de Bernard Arnault ou François Pinault –, la série ne cesse de s’en amuser et de surenchérir au centuple sur Malraux : le cinéma est lié si inextricablement aux circuits industriels qu’il n’y compte même plus que comme un faire-valoir de la « vraie » industrie, comme une pré-bande annonce pour un spot publicitaire de parfum de luxe. Et pourtant, dans cette niche, quelque chose peut advenir, quelque chose de si universel, de si inaliénable, de si transcendant, que tous les capitaines d’industrie s’y précipitent presque involontairement pour renouer avec la fonction sociale traditionnelle du mécène : mettre en rapport via l’art la faux du présent avec un parfum d’éternité – qui n’a pas de prix.
Pour le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le chef du service de l’accompagnement des politiques éducatives,
Jean Hubac
